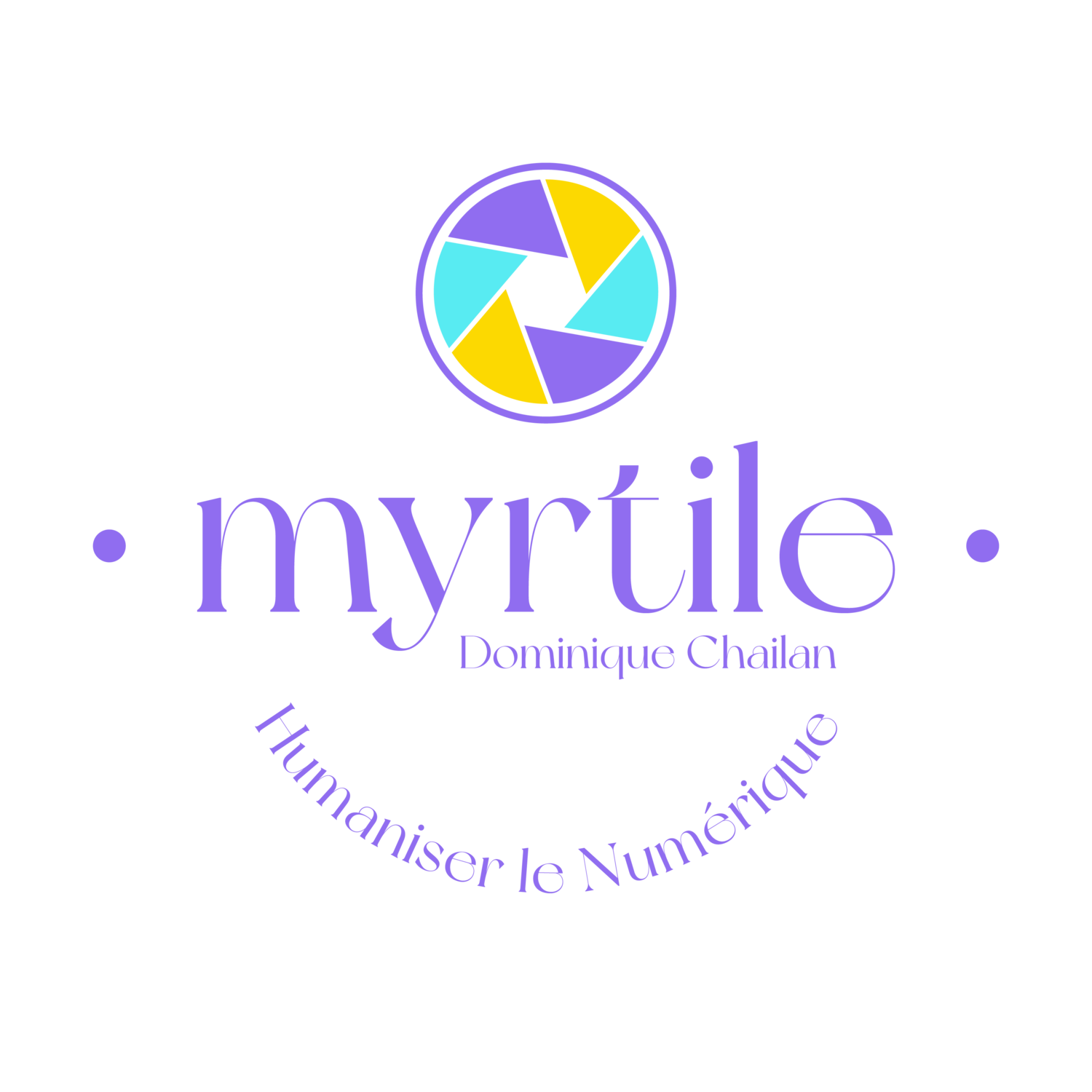Carmen Curlers, série danoise
Allez, j’t’raconte une série parce que l’histoire des médias et du cinéma, c’est mon truc et que j’ai vraiment envie de partager mes réflexions par rapport à cette série danoise qui se passe en 1963.
A l’écriture de ce billet, j’ai terminé la première saison qui, comme les séries européennes, est courte : 8 épisodes et c’est bien aussi. J’ai moins l’impression que les producteurs ont demandé aux scénaristes de faire du remplissage pour absolument aller au bout des 20 et quelques épisodes.
Je ne dis pas que c’est long, juste que c’étaient des formats qui fonctionnaient bien quand on attendait l’épisode suivant à la télévision d’une semaine sur l’autre et non spa avec la possibilité de tout visionner d’un seul coup comme aujourd’hui.
Le fameux cliffanger* prenait même un sens littéral puisqu’il fallait attendre physiquement une semaine pour avoir la réponse à une question ou la résolution d’un problème ou d’une énigme dans l’énigme.
La construction des séries s’est ordonnée, théorisée et le modèle américain s’est répandu alors qu’en Europe et en France, la culture est différente. Quoi qu’il en soit, j’aime les petites saisons.
Carmen Curlers, le pitch
1963, Danemark, une petite ville où se retrouvent les agriculteurs d’un côté, les notables et industriels de l’autre fait se rencontrer un jeune homme, marié, avec un enfant, ambitieux et qui veut lancer des inventions nouvelles comme des bigoudis chauffants. Il s’endette puis finalement avec l’aide d’un coiffeur et d’une agricultrice, monte une usine et commence à décoller grâce à la publicité inattendue d’une actrice célèbre.
Au-delà de cette success story de base, semée d’embûches, énormément de thèmes sont abordés et c’est ce qui rend moderne, universelle et parlante, même aujourd’hui et on peut se dire à certains moments « qu’est-ce qui a vraiment changé en 60 ans ? »
Les thèmes en vrac
La condition de la femme à la ville et à la campagne
La femme-objet
La fille-mère
L’avortement caché
La virilité masculine
La toute puissance masculine
Le pouvoir par l’argent
L’humiliation/le bizutage
La mère avant la femme
L’émancipation de la femme par l’argent
La harcèlement psychologique et physique admis
L’héritage familial
L’humiliation de la mère castratrice
L’homosexualité et l’apparence
La femme objet sexuel (même) instruite
La construction et la réalisation
Au-delà du récit, le fond et la forme se rejoignent et sont parfois en dissonance ou en accord. Les premières fois que j’ai vu ces audaces sont dans les films de Xavier Dolan qui utilise les différences de cadres pour appuyer son propos (Mommy). Les séries ont souvent pris des libertés dans la construction et les effets que le cinéma se permet peu. Devenu 7e art, il a acquis comme le théâtre, une image de « sérieux » et d’académique qui lui a parfois enlevé son audace comme l’ont fait les réalisateurs de la nouvelle vague**
Et je suis aussi surprise par cette irruption de la danse – influence Bollywwod ? – La danse et la musique font normalement partie de la narration et s’inscrivent dans une scène (bal, soirée…) mais là, non.
Et vous verrez donc dans Carmen Curlers les ouvrières et le patron faire des pirouettes comme dans West Side Story au beau milieu de l’usine.
La saison 1 se termine avec une belle victoire de cette aventure avec son patron borderline, cynique avec des fêlures.
À noter qu’un épisode entier est consacré à son collaborateur homosexuel et à la découverte de cet aspect de lui-même.
Sur Arte en Replay
*effet tiré littéralement de suspendu et qui laisse justement du suspens à la fin de l’épisode pour donner envie de voir le suivant
**mouvement des années 1960 en France avec des réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnès Varda